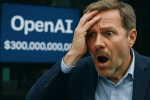Nous vivons bien dans une drôle d’époque, mes chers lecteurs, un temps où la science et la loi s’entrechoquent parfois de la façon la plus étrange. Vous avez bien sûr entendu parler de cette loi de bioéthique de 2021. Un texte législatif qui, en plus de donner des maux de tête aux conservateurs, a ouvert une boite de Pandore pour ceux nés d’un don de sperme ou d’ovocytes. Vous savez, ce petit tas de cellules que votre gentil voisin de palier est allé déposer à la clinique il y a une vingtaine d’années, anonymement bien sûr.
Maintenant, grâce à cette loi, les bambins de ces généreux donateurs – devenus adultes – peuvent enfin lever le voile sur une partie de leur histoire. Comment ? Simplement en faisant une demande à une commission créée pour l’occasion. Cette commission a la lourde tâche de révéler aux bénéficiaires du don de gamètes l’identité de ce monsieur ou cette madame qui a, en quelque sorte, participé à leur conception.
C’est ainsi que deux sœurs ont finalement rencontré leur père biologique. Leur familiarisation avec leur père donneur de gamètes s’apparente à la résolution d’un vieux casse-tête familial. Elles ont décrit cette réunion comme « retrouver la pièce manquante du puzzle ». Pas étonnant, quand on pense à toutes les informations génétiques et historiques qui leur ont été dissimulées jusqu’à présent.
Alors, cette loi, un pas en avant ou en arrière pour notre société ? Sans aucun doute, cela dépendra de votre point de vue. Certains crieront à l’intrusion dans la vie privée, d’autres à la justice enfin rendue. Un fait est sûr : cette loi a déjà commencé à bousculer des vies, à révéler des vérités cachées et à reconnecter des familles. Le tout sous le prétexte de transparence et de droit à l’information. Mais à quel coût? Et jusqu’où irons-nous dans cette quête incessante de transparence ? Le temps, comme toujours, sera le vrai juge de cette loi.